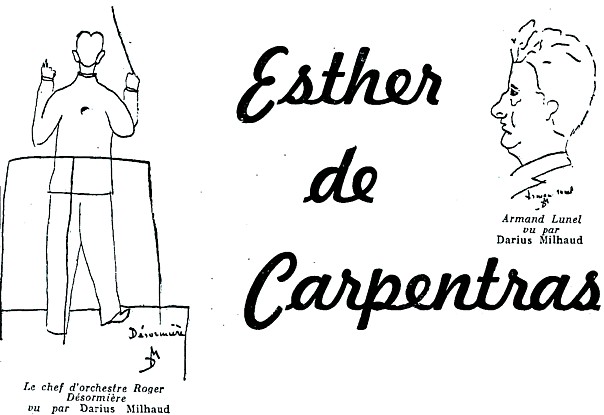
On pourra lire ci-dessous l’article publié dans Ce soir. Grand quotidien d’information indépendant, n° 334, dimanche 30 janvier 1938, à l’occasion de la création à Paris de l’opéra-bouffe Esther de Carpentras de Darius Milhaud, d’après une pièce de théâtre d’Armand Lunel qui l’a adaptée pour le livret. Il est suivi d’un bel article élogieux que La Revue des deux mondes publiera deux mois plus tard.
C’est le mardi 1er février, en matinée, que sera représentée, pour la première fois à Paris à l’Opéra-Comique « Esther de Carpentras », dont M. Armand Lunel a écrit le livret et M. Darius Milhaud la partition musicale.
Voici le texte que M. Armand Lunel a bien voulu nous confier et qui résume l’action de cet opéra-bouffe, que la radio avait déjà fait connaître par les soins de l’Orchestre national.
Esther de Carpentras est un opéra-bouffe en deux actes, d’inspiration à la fois juive et provençale. Darius Milhaud et moi-même sommes deux amis d’enfance, que de nombreux liens ont, depuis longtemps, rapprochés l’un de l’autre. Nos deux familles, en effet, descendent d’une de ces vieilles communautés israélites qui, avant la Révolution, formaient à Avignon et à Carpentras, dans les États français du Saint-Siège, des républiques en miniature, très fières de leurs privilèges et fort reconnaissantes à la Papauté de la protection si précieuse qui leur avait toujours été accordée.
En écrivant Esther de Carpentras, nous nous sommes inspirés d’un modèle traditionnel qui remonte au moyen âge. Tous les ans, au mois de mars, les Juifs célèbrent, à la synagogue, la fête de Pourim, qui rappelle l’intervention miraculeuse de la reine Esther auprès du roi Assuérus pour délivrer les israélites de la persécution de son ministre Aman, qui avait fixé par le sort la date de leur massacre. Mais du temps des ghettos, Pourim était une véritable fête publique, et même une sorte de carnaval. Jusqu’à la fin du xviiie siècle, les Juifs de Carpentras organisaient, à cette occasion, des représentations populaires de la légende biblique, qui avaient lieu en plein air, sur la place principale de la Juiverie. Ces pièces furent d’abord écrites en hébreu, puis en provençal; on les a comparées aux mystères du moyen âge, car le ton de la farce et de délicieuses naïvetés s’alliaient ici naturellement à la solennité religieuse et formaient, un peu aussi comme dans les Pastorales provençales un mélange bien savoureux.
Esther de Carpentras comprend deux parties.
Le premier acte forme un prologue où l’on voit trois vieux Juifs du ghetto de Carpentras : Artaban, financier, Barbacan, concierge de la synagogue, et Cacan, amateur de théâtre, venir en délégation chez le cardinal-évêque de la ville pour lui demander la permission, selon l’usage, de représenter, le lendemain, le drame d’Esther. Dans l’antichambre de l’évêché, ils sont d’abord reçus assez mal par Vaucluse, le valet du cardinal. Ce Vaucluse a toujours eu une marotte bien innocente : celle de convertir les Juifs du comtat venaissin en leur chantant des Noëls qu’il compose à ses heures de loisir; mais les trois ambassadeurs du ghetto font la sourde oreille à cette tentative de conversion en musique et, au moment où Vaucluse va les’ mettre à la porte, le cardinal-évêque fait son entrée. C’est un, prélat encore assez jeune, tout bouillant de zèle et en même temps plein de bonhomie. Comme il est arrivé tout récemment de Rome, il se trouve tout surpris de découvrir des Juifs d’une espèce si singulière à Carpentras ; il s’en amuse d’abord un peu, puis il leur accorde l’autorisation qu’ils sont venus très respectueusement lui demander. Mais, dès qu’ils sont partis, il se promet in petto de profiter de cette représentation de la Reine Esther pour faire encore mieux que Vaucluse et tenter une conversion en masse de tous les Juifs de la ville.
Le rideau tombe : c’est une affiche qui porte en énormes caractères : « La Reine Esther, improvisée par les Juifs de Carpentras. »
Aux angles s’inscrivent mystérieusement, en caractères hébraïques, les versets qui, au chapitre IX du livre d’Esther, prescrivent la célébration des jours de Pourim.
Et quand le rideau se relève pour le deuxième acte, nous sommes maintenant sur la place de la Synagogue dominée par les hautes maisons de la Juiverie. Toutes les fenêtres sont ouvertes et pavoisées, en l’honneur de Pourim, avec des châles et des tapis qui se détachent, sur les sombres façades, en couleurs claires. On aperçoit à gauche une barrière gardée par les sergents du cardinal et, à droite, un théâtre en plein vent où les Juifs ont cru représenter la Porte (au sens oriental) d’un monarque perse. Toute la jeunesse juive de Carpentras, déguisée avec tous les costumes de tous les Juifs d’Europe, commence à se répandre joyeusement et à babiller sur la place. C’est donc bien un véritable carnaval, où l’on verra même un médecin de la peste chanter sa chanson.
On distingue aussi dans la foule une marchande de masques qui fournira les costumes et les accessoires aux acteurs improvisés. On retrouve le fier Artaban qui choisit le rôle d’Assuérus, et le plaintif Barbacan qui assumera le rôle de Mardochée. Cacan, non seulement est .promu directeur du spectacle, mais encore chef du sérail ; quant au rôle d’Aman, il sera joué par Mémucan, un pauvre diable d’astrologue que tout le monde méprise.
La pièce commence donc à se dérouler comme d’usage et selon les rites habituels : Assuérus commande un énorme festin et demande au gardien du sérail de lui procurer une nouvelle épouse ; ce sera Esther, dont le rôle sera joué par la nièce de Barbacan, comédienne de profession. On assiste à sa toilette, on écoute ses imprécations et les lamentations de Mardochée qui se dispute avec Aman ; ce dernier, pour se venger des Juifs, tire au sort la date de leur extermination. Mardochée demande alors à Esther d’intervenir auprès du roi pour sauver ses frères ; le roi, qui se rappelle à ce moment-là que Mardochée lui a rendu un grand service, ordonne à Aman de rendre un hommage solennel à Mardochée.
On s’attend donc à ce que la pièce continue par la grande scène classique où Esther obtient d’Assuérus la grâce des Juifs : mais voilà que tout à coup Vaucluse et le cardinal-évêque font irruption sur la place de la Juiverie et annoncent à tous les Juifs consternés qu’ils seront bannis de Carpentras s’ils ne se convertissent pas en masse immédiatement. La grande scène entre Esther et le roi Assuérus se trouve, de ce fait, remplacée par une scène imprévue entre Esther et le cardinal-évêque qui, finalement, se laisse apitoyer et fléchir.
Le drame s’achève par un double chœur : d’un côté celui du chapitre qui vient chercher l’évêque, de l’autre celui des Juifs qui remercient l’Éternel. Tout rentre ainsi dans l’ordre; car, dans la veille Juiverie de Carpentras, sous ce ciel méridional et tolérant, les voix de l’Ancien et du Nouveau Testament ont pu résonner pendant de longs siècles sans la moindre fausse note.
Armand LUNEL
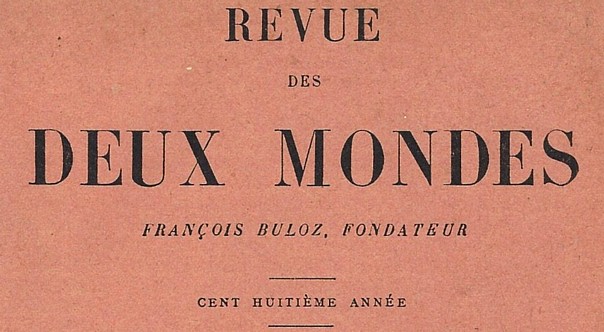
Article publié dans La Revue des deux mondes, première quinzaine de mars 1938.
Le nouveau spectacle de l’Opéra-Comique réunit trois ouvrages de M. Darius Milhaud. Un seul avait déjà été mis en scène. C’est, en manière d’introduction, la « complainte » du Pauvre matelot, reprise après une dizaine d’années, mais dans une autre orchestration, de style concertant, qui est fort savoureuse, encore que peut-être un peu trop corrosive. […]
Après ce sombre préambule, Esther de Carpentras est une fête de lumière. La partition pourtant fut achevée a peu près vers la même époque. Mais M. Darius Milhaud n’a rien du doctrinaire; et sa musique est assez riche pour répondre à plus d’une demande. Une aussi longue attente, en pleine maturité, doit servir de leçon à une jeunesse impatiente qui est loin de posséder les mêmes titres, mais ne cesse de réclamer, et souvent obtient un tour de faveur.
C’est un opéra-bouffe, au sans complet du mot, défini a la fois par le ton du poème et le caractère de la musique. M. Armand Lunel y conte avec esprit une plaisante histoire de son pays natal. Là, comme en Avignon, les Juifs, depuis le moyen âge et jusqu’à la fin de l’ancien régime, formaient une communauté plus libre que partout ailleurs, car ils étaient les sujets du Saint-Siège, qui les a toujours protégés. Très attachés à leurs coutumes, ils savaient tenir tète aux chrétiens et souvent l’on disputait ferme, mais sans brutalité, sous le ciel clair de la Provence, qui rend les hommes raisonnables ; et, au xviiie siècle, les idées semblaient s’adoucir sous la politesse des mœurs.
C’est en ce temps que nous voyons trois délégués des Israélites introduits dans l’antichambre du cardinal-évêque, où dort sur deux fauteuils un valet en livrée écarlate. Il s’éveille et, les apercevant, entreprend aussitôt de les convertir. C’est un dévot qui compose de pieux cantiques,.et leur en chante un de sa façon, mais sans aucun succès. Son maître est un généreux étourdi, neveu du Pape et cardinal à dix-huit ans. Il écoute en souriant la requête qui lui est présentée : il s’agit d’obtenir, pour la fête juive du lendemain, l’autorisation de représenter sur la place publique l’histoire d’Esther. Il y consent d’abord, ne se faisant prier que pour la forme. Mais, à peine les Juifs partis, une autre idée lui vient, et on devine qu’il leur ménage une surprise.
La fête est une sorte de carnaval israélite, à la mode provençale, avec masques, serpentins, confetti. On y chante, on y raille, et on y danse en rond. On se déguise en Juif de Prague, de Francfort ou de Rome. Les patriarches de la synagogue sourient dans leurs barbes aux jeux de leurs enfants. La représentation annoncée commence, et les acteurs bénévoles y mettent beaucoup de verve, mais un incident imprévu les arrête avant que la tremblante Esther ait pu se jeter aux pieds d’Assuérus. C’est le cardinal qui arrive, superbement drapé en son manteau rouge, et prononce un menaçant discours : les Juifs doivent se convertir en masse, le jour même, ou seront expulsés de la ville. C’est ainsi que, dans l’emportement d’un zèle juvénile, il entend profiter de la circonstance qui les tient rassemblés devant lui. Alors survient Esther qui feint une méprise, et achève avec lui la scène qui manquait à l’histoire biblique. Pas plus que le monarque persan, le prince de l’Église ne se montre insensible à une supplication qui le flatte et le charme. Les Juifs rassurés lui rendent grâces, et leurs voix répondent à celles des prélats et des enfants de chœur venue à en rencontre, dans la tranquillité des consciences et l’apaisement d’un beau jour.
Ce joli conte donne lieu à des scènes légèrement burlesques, où pourtant il y a toujours du vrai ; mais on ne fait qu’en rire, faute de temps pour y penser. La piété, la colère, l’effroi, l’attendrissement et la reconnaissance y sont parfaitement sincères, mais n’apparaissent que pour s’effacer aussitôt, emportés dans un mouvement de gaieté que la musique, loin de le ralentir, vient stimuler encore. C’est là un avantage rare, dans un ouvrage qui, comme celui-ci, est chanté d’un bout à l’autre et n’a pas recours au subterfuge du dialogue parlé.
Le mérite en revient tout d’abord au poète, qui a prie la précaution élémentaire, mais trop souvent omise, de resserrer son texte, et de ne le composer que de mots pleins et sonores, où la musique peut s’accrocher directement, sans notes superflues, sans transitions incertaines. Le musicien a pu ainsi donner libre cours ù sa verve précise. Chaque scène aboutit promptement à un air, sur un motif en relief, qui lui impose sa forme. C’est dans un mouvement de polka que le valet déplore la légèreté de son maître. Mais celui-ci, quand il procède à son examen de conscience ou fait connaître aux Juifs se religieuse volonté, place sur la rigueur d’une basse contrainte des traits qui semblent se souvenir du plain-chant. Le balancement de la maxixe ajoute une ironie un peu désenchantée au boniment d’Esther qui se présente comme « étoile du théâtre judaïque ». Le chœur joyeux des Juifs, au début de la fête, est une fugue régulière, avec ses modulations et la strette finale, comme celle des buveurs dans la Damnation de Faust, et pour le même eflet de plaisanterie poussée à bout, dans une inflexible logique. Mais leur chant d’actions de grâces, au dénouement, a le clair refrain et l’innocente harmonie d’un cantique. Ainsi toutes les figures du langage musical viennent tout a tour se mettre à la disposition de l’auteur, qui jamais n’en abuse. Son style toujours réduit à la plus simple expression ignore l’amplification et se passe de commentaire : tout est net et formel.
Dans l’orchestre, de même, rien n’est mis pour ajouter une pointe de couleur ou remplir l’harmonie. Chaque partie a sa ligne, d’un accent décisif, et s’y tient sans faiblir. À chacune s’attache une sonorité franche qui fait corps avec elle. Leur contact produira de complexes accords dont pourtant l’origine n’est jamais douteuse, et un frémissement de vibrations distinctes en réaction mutuelle. Cette musique en état de sursaturation peut se désagréger au moindre choc : il ne restera plus qu’un grumeleux mélange, que l’oreille ne peut accepter. Pour le garder fluide, les règles de l’école ne sont pas suffisantes ; mais il faut les avoir apprises, et même s’en être pénétré au point d’atteindre par delà jusqu’aux lois non écrites dont le sentiment seul est juge, s’il a été guidé vers elles par l’étude. M. Milhaud a le droit d’explorer ce domaine, parce qu’il en sait assez long pour ne pas s’égarer ; à l’ignorant qui s’y aventure au hasard, il faudrait l’interdire.
Livrée à elle-même, la symphonie jaillit en traits fougueux qu’un rythme sûr entraîne et qui s’entrechoquent à point nommé pour illuminer l’espace qui les entoure de leurs fulgurations multicolores ; c’est ainsi qu’est formé l’éblouissant entr’acte, fête des sons avant la fête de la scène, plus éclatante et mieux réglée aussi, car la musique y brûle, sans une éclaboussure. Mais si la voix humaine s’élève, la trame instrumentale se détend et s’écarte pour lui donner passage, et on la saisit d’autant mieux que sa partie dans le concert est aussi accusée que les autres, qui ne peuvent mordre sur elle.
Le même procédé est appliqué aux dialogues qui rattachent les airs l’un à l’autre, et que, jusqu’à nos jours, un musicien se fût efforcé de traduire en récitatif. Ici, tout est mis en musique. L’orchestre, au lieu d’étaler sous la déclamation notée comme un tapis de plats accords, se relève en motifs saillants dont l’impulsion se communique à la voix : en réponse, elle chante à son tour. On s’aperçoit alors que le récitatif n’était qu’un leurre. Si la musique s’amollit au point de se plier docilement à l’accent du discours, c’est elle qui parle un langage inarticulé, qu’on ne peut écouter, faute de le comprendre. D’où le soin que l’on prend de faire le vide autour d’elle, afin de ne pas distraire l’attention, qui cependant n’arrive pas à s’y fixer. Au contraire, pour l’attacher fortement à la phrase du texte, il .faut en faire une phrase musicale. Il suffit que l’accent tonique, qui en notre langue n’est pas très fortement marqué, soit observé dans les endroits où le discours y trouve un appui. Ailleurs, quelques déplacements ne tirent pas à conséquence. Ce sont licences que se sont toujours permises, non seulement les airs d’opéra, mais aussi les chansons populaires, où pourtant il importe d’entendre, de comprendre et de retenir les paroles : personne n’en fut jamais gêné. Il en est de même ici : la musique vient à nous, elle apporte le texte et le dépose en notre esprit.
La partition entière se trouve ainsi tressée en un faisceau d’idées qui se soutiennent et s’accrochent l’une à l’autre. Le mouvement est sans arrêt, mais aussi sans écart, et si l’auteur s’amuse, ce n’est pas d’un détail « amusant ». Sa joie est plus profonde, car elle vient du cœur. Tout d’abord, on hésite à reconnaître le grave musicien des Choéphores, de Maximilien, de Christophe Colomb. C’est bien lui cependant, jouant de sa puissance. Si le trait est léger, l’armature est solide, et c’est précisément ce fond de sérieux qui donne au divertissement sa force et sa valeur.
Mlle R. Gilly est fort agréable à voir et à entendre sous les atours de la séduisante Esther. M. P. Vergnes a la rondeur de voix et de geste qu’il fallait à ce bouillant Cardinal. Les autres rôles sont habilement tenus par Mlle Drouot, MM. L. Arnoult, Pujol, Hérent, Poujols, Balbon, Guénot. Les décors et les costumes de Mme Nora Auric sont d’une fraîcheur et d’une vivacité extrêmement plaisantes, où l’air circule, et la lumière. Ce petit ouvrage est sans doute le plus achevé et le mieux réussi que l’Opèra-Comlque nous ait offert dans le genre gai, depuis quelques années qu’on tente de l’y remettre en honneur.
La Suite provençale, pour terminer le spectacle, invitait à la danse sur des airs du pays, cueillis avec amour, comme un bouquet de fleurs sauvages, et enveloppés d’un orchestre non moins vibrant, mais d’une délicatesse qui n’y touche que pour en aviver le coloris, en exalter l’arome. […]
C’est ainsi que nous fut montré, sous trois aspects divers, en complète possession de ses moyens, toujours maître de ses effets, un beau talent de musicien. M. Roger Désormière, qui dirigeait l’orchestre, a su, en chaque occasion, lui imprimer le ton, l’accent et le mouvement qu’il fallait, avec autant d’intelligence que de sentiment musical.
Louis LALOY
